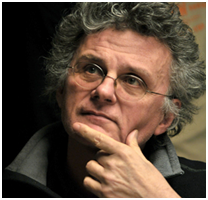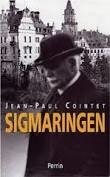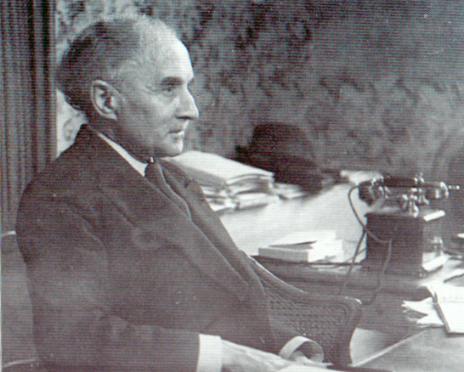1- Stendhal voyageur impénitent
La documentation à ce sujet étant pléthorique, il m'a semblé intéressant après un bref panorama du "Stendhal voyageur", de présenter ses trois ouvrages qui concernent l'Italie, "Rome, Naples et Florence", "Promenades dans Rome", "Chroniques italiennes", la relation de ses voyages en France dans "Mémoires d'un touriste" ainsi qu'un complément sur son essai "Histoire de la peinture en Italie".
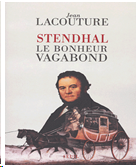

 Santa-Maria del Fiore
Santa-Maria del Fiore
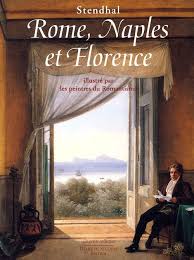

3- STENDHAL : Promenades dans Rome


Attention cependant nous prévient-il, de ne pas vouloir "tout voir", d'être atteint du « dégoût de l’admiration » et il veut mieux alors aller se distraire avec les Romains sans toutefois ajoute-t-il ironique, «se brouiller avec sa cour et sans déplaire au pape. » Dans cette Rome soumise à l'imagination de Stendhal, il fait aussi œuvre didactique, incluant une documentation intéressante sur la ville où l'art, l'histoire romaine et la papauté tiennent une place importante, tout comme les descriptions, les conditions de son voyage à une époque où il fallait souvent compter une quinzaine de jours pour parcourir la distance entre Paris et Rome.
Curieusement, ces "promenades romaines" nous entraînent aussi -comme son livre précédent "Rome, Naples et Florence" (voir article ci-dessus)- dans ces deux dernières villes. Il se réconcilie avec Naples, le théâtre San Carlo où chante le grand Lablache et il est transporté par Florence, même s'il trouve ses habitants "trop français", artificiels et prétentieux. C'est à Florence qu'il rencontre Lamartine, alors secrétaire à la Légation de France, rencontre heureuse qui lèvera bien des préventions entre les deux écrivains.
Ceci dit, la trame d'un guide nommé Stendhal qui entraîne un groupe à la découverte de Rome est purement imaginaire. A la date supposée du départ de la visite le 3 août 1827, il est à Gênes où il rencontre Manzoni et non à Rome et personne n'a trouvé trace de l'épigraphe qu'il attribue à Mercurio dans le Roméo et Juliette de Shakespeare : « J'ai vu de trop bonne heure la beauté parfaite... » C'est en fait du pur Stendhal !



Trop de faveur tue L'abbesse de Castro Vanina Vanini & La duchesse de Paliano
Cet ensemble de récits qui datent de la Renaissance, sont marqués au sceau de la violence et de la passion, donc d'un romantisme, imprégnant les textes de Stendhal. Après être parus dans la Revue des deux mondes, ils seront réunis en recueil auquel s'ajoutera La Duchesse de Palliano ainsi que deux œuvres posthumes, Trop de faveur tue et Suora Scolastica. C'est son cousin Romain Colomb, son exécuteur testamentaire, qui imposa le titre de « Chroniques italiennes » pour la réédition de 1855.
De ces huit récits, les plus connus sont certainement "Vanina Vanini" et "La Duchesse de Palliano" mais d'autres méritent aussi d'être présentés . Vanina Vanini narre l'histoire de Pietro Missirilli, un carbonaro qui réclame la liberté pour son pays, et de Vanina, jeune princesse orgueilleuse. Son père veut la marier à un prince, Don Livio Savelli mais Vanina refuse cette union, éprise du beau carbonaro blessé d'un coup de poignard, que son père héberge dans sa demeure romaine. Mais, jalouse de l'engagement patriotique de Livio parti en Romagne, elle dénoncera ses amis et lui par solidarité se livrera avec eux. Vanina, torturée par la culpabilité, et emprisonnée et rejetée par Livio qui finira cependant par succomber à ses charmes.
Vittoria Accoramboni a tout pour elle, la beauté, la naissance, le charme... et est très heureux après son mariage avec Félix Peretti. Mais Félix est mystérieusement assassiné en pleine rue de trois coups d’arquebuse. On soupçonne quand même le prince Orsini qui aurait même pu agir avec le consentement de la famille de Vittoria. Soupçon augmenté le jour où elle épouse le prince Orsini alors que le frère de Félix, le cardinal Montalto, devient pape sous le nom de Sixte-Quint. Le dénouement sera tragique : après le décès du prince, Vittoria et ses frères sont assassinés par le frère du prince Louis Orsini, jaloux que Vittoria hérite; mais il sera finalement emprisonné puis étranglé.
Les Cenci
 Les Cenci
Les Cenci
François Cenci est un don Juan fortuné et renommé pour son courage. Après le décès de sa première femme, malgré ses sept enfants, il épouse Lucrèce Pétroni. Mais c'est un violent qui bat sa femme comme ses filles, en particulier Béatrix Cenci victime d'une tentative de viol. A la maison, le climat devenant irrespirable, Béatrix et sa mère aidées de deux hommes tuent François Cenci, Béatrix parvenant à faire croire à un accident. Mais la police papale veille et les deux femmes finissent par passer aux aveux. Malgré l'aide de plusieurs cardinaux seul le plus jeune des frères sera sauvé. Elles monteront à l'échafaud avec une dignité telle qu'elles forcent l'admiration de leurs concitoyens.


Béatrice Cenci 1599 par Guidi Reni par Harriett Hosmer (1857)
La Duchesse de Palliano
Jean-Paul Carafa, avec l'aide de son cousin Olivier Carafa, est nommé pape sous le nom de Paul IV. Rapidement, il nomme ses trois neveux à des postes d'importance, l'un d'eux le duc de Palliano, marié à Violante de Condone, très belle et très orgueilleuse. Les deux autres neveux ne sont pas mieux et le pape, lassé de leurs incartades, se résout à les chasser. Sur ces entrefaites, la duchesse prend un amant, un nommé Marcel Capece mais sa suivante, par vengeance, raconte tout au duc. L'imbroglio vire à la tragédie quand le duc exécute l'amant de sa femme et sa suivante qui avait dévoilé l'affaire, et devant l'insistance de son entourage, finira par se résoudre à faire supprimer la femme adultère. Le nouveau pape Pie IV fait mettre à mort le duc et son frère cardinal mais son successeur Pie V réhabilitera leur mémoire.
L’Abbesse de Castro
La campagne autour de Rome, la charmante ville d'Albano en 1542 où vit la puissante famille des Campireali.
Hélène de Campireali est renommée pour sa beauté exceptionnelle. Comme dans les contes, elle est courtisée clandestinement par Jules Branciforte, pauvre brigand qui lui envoie un bouquet qui cache un mot d'amour. Malheureusement, il est démasqué par le père et le frère d’Hélène mais il réussit à renouer avec la jeune fille, lui avouant sa modeste condition.
Au cours des luttes pour le pouvoir qui opposent les deux familles les plus puissantes de Rome, les Colonna et les Orsini, Jules est amené à tuer Fabio Campireali le frère d'Hélène, tandis qu’Hélène a été expédiée au couvent de Castro . Situation cornélienne s'il en est. Hélène finira par lui accorder son pardon et il essaiera de l'enlever du couvent où elle est fort bien gardée, mais blessé pendant sa tentative, il échouera.
Hèlène s'enfuit alors du couvent, déguisée en ouvrier mais Jules, pourchassé, menacé de mort, s'est embarqué pour Barcelone. Le croyant mort, elle retourne au couvent et parvient à en devenir l'abbesse. Mais Hélène commet une terrible imprudence et tombe enceinte de l'évêque, Francesco Cittadini. Accouchement clandestin bien sûr mais elle sera dénoncée par la sage-femme, condamnée par l'impitoyable cardinal Alexandre Farnèse, pape sous le nom de Paul III et tentera de s'évader par un passage souterrain. Tandis que Jules revient d'Espagne après la mort du pape, bénéficiant d'une période de vacance du pouvoir, [8] elle tire les leçons de son inconduite et il arrive trop tard, la trouve morte, « la dague dans le cœur ».
Mémoires d'un touriste & Voyage dans le mid
Cet ouvrage, écrit entre 1812 et 1816, mêle en effet souvenirs personnels, histoire et développements artistiques. Il y commente des œuvres de Guido Reni ou Le Corrège mais s'attarde surtout sur Léonard de Vinci et Michel-Ange. [9]
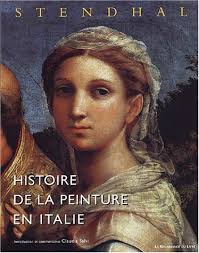

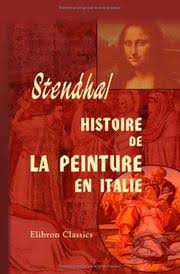
Différentes éditions de son essai
Partant des primitifs, son parcours est sans grande cohérence, intéressant quand même à une époque où on manquait de documentation sur ces questions. Il y développe cependant ses conceptions sur l'art, en particulier la relativité du concept de beauté en art, cette distinction importante entre les notions de «Beau moderne» et de «Beau idéal», qu'il reprendra dans la querelle du romantisme.

Notes et références
[1] Jean Lacouture, "Stendhal, le bonheur vagabond", éditions Le Seuil, janvier 2004
[2] Voir ses "Souvenirs d'égotisme" que Stendhal écrivit quand il était consul à Civitavecchia, Flammarion, collection GF, 204 pages, 2013
[3] Stendhal, "Rome, Naples et Florence", illustrés par les peintres du romantisme, éditions Diane de Selliers, 2002
[4] Voir Stendhal, "Histoire de la peinture en Italie", Gallimard, collection Folio essais, 720 pages, 1996
[5] La beauté est pour lui «pleine d’âme et de feu», écrit-il dans "Promenades dans Rome" à propos des jolies femmes de Rome remarquées la veille au soir au concert.
[6] Préface à "Promenade dans Rome" par Michel Crouzet, Gallimard, Folio classique, 1997
[7] Chroniques italiennes : Vittoria Accoramboni, Les cenci, La Duchesse de Paliano, L'Abbesse de Castro, Trop de faveur tue, Suora Scolastica, San Francesco a ripa, Vanina Vanini, 1837-1839
[8] Paul III meurt le 10 novembre 1549 alors que Jules III son successeur, ne sera élu que le 7 février 1550
[9] Stendhal, "Histoire de la peinture en Italie", éditions Gallimard, établie par Vittorio del Litto, Folio-essais, 720 pages, 1996
Voir l'ensemble de mes fiches sur Stendhal :
* Stendhal, « Un européen absolu »
* Stendhal et La découverte de l'Italie -- Stendhal et La campagne de Russie --
* Stendhal : Armance -- Stendhal : Lamiel -- Stendhal : Lucien Leuwen
* Stendhal consul à Civitavecchia -- Stendhal : Mémoires d'un touriste
* Vie de Henri Brulard -- Stendhal à Lyon, C. Broussas
Autres références
* Beyle, Stendhal, Brulard, Le rouge et le noir, La chartreuse de Parme, Stendhal à Grenoble et à Paris
* Présentation générale des œuvres de Stendhal
L'attrait de Stendhal pour les voyages remonte sans doute à son enfance grenobloise dont il parle dans son récit autobiographique la Vie de Henry Brulard : il visite déjà à diverses reprises les environs de sa ville natale ainsi que la Savoie
toute proche. Mais c'est l'épopée napoléonienne qui le jette à travers
l'Europe avant d'être enthousiasmé par l'Italie. Son ami Mérimée disait de lui qu'il avait besoin de « locomotion
», aime voyager, curieux avant tout des gens et du monde qui l'entoure,
notant ce qu'il voit et ce qu'il ressent au fil de la plume.
La documentation à ce sujet étant pléthorique, il m'a semblé intéressant après un bref panorama du "Stendhal voyageur", de présenter ses trois ouvrages qui concernent l'Italie, "Rome, Naples et Florence", "Promenades dans Rome", "Chroniques italiennes", la relation de ses voyages en France dans "Mémoires d'un touriste" ainsi qu'un complément sur son essai "Histoire de la peinture en Italie".
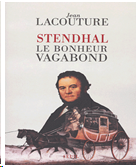
« Ce que j'aime dans les voyages, c'est l'étonnement du retour. » Stendhal
Même si Stendhal
a plutôt traité dan son œuvre littéraire les tourments du cœur sans
beaucoup s'atteler à raconter des histoires ou écrire des romans
d’aventure, il a été dans sa vie un grand voyageur, préférant parcourir
l'Italie plutôt que de voyager dans sa tête. A plusieurs reprises, il
va sillonner l'Europe du col du Grand Saint-Bernard à Berlin, du Danube à la Bérézina, de la Calabre à la Catalogne, en chemins de fer aussi bien qu'en en calèche ou en diligence. Il est parfois pris d'une « fringale de départs et de flâneries audacieuses... entre deux amours et deux livres ». [1] Stendhal, cet "européen absolu" selon l'expression de Nietzsche, saute dans une diligence à la moindre occasion. Par contre, quand il écrit, il écrit... pour preuve, Stendhal dicta l'essentiel de La Chartreuse de Parme en cinquante-trois jours, enfermé dans sa chambre de la rue Caumartin à Paris.
S'il naît à Grenoble le 23 janvier 1783, dès 1800 il rejoint la capitale et on le retrouve rapidement dans les Alpes en route pour l’Italie, sous lieutenant d'un certain Bonaparte. Il n'y restera pas longtemps, l'ambiance de l'armée lui déplaît, sait qu'il est déjà « passionné par les voyages en ce moment. Quand on sait voyager, cela fait bien connaître les hommes.» Fondamental pour un futur écrivain. On le retrouve ensuite en Allemagne à partir de 1806 et trois plus tard, il débarque à Vienne qui lui apparaît comme « une grande ville de province en France.»
S'il naît à Grenoble le 23 janvier 1783, dès 1800 il rejoint la capitale et on le retrouve rapidement dans les Alpes en route pour l’Italie, sous lieutenant d'un certain Bonaparte. Il n'y restera pas longtemps, l'ambiance de l'armée lui déplaît, sait qu'il est déjà « passionné par les voyages en ce moment. Quand on sait voyager, cela fait bien connaître les hommes.» Fondamental pour un futur écrivain. On le retrouve ensuite en Allemagne à partir de 1806 et trois plus tard, il débarque à Vienne qui lui apparaît comme « une grande ville de province en France.»
En 1811 il découvre tout à la fois l'Italie, la beauté de la peinture de ce pays et... la belle Angela. Infatigable voyageur, protégé son cousin le comte Pierre Daru, il suit l'épopée napoléonienne, en particulier les tribulations de l'armée française en Russie et passe par miracle la Bérézina le soir du 27 novembre 1812 peu avant l’effondrement du pont et tout fier de lui, il a e commentaire : « Ce voyage m’a fait voir des choses qu’un homme de lettres sédentaire ne devinerait pas en mille ans.»

Sa maison d'enfance, celle de son grand-père le Dr Gagnon
Après deux passages à Londres en 1821 et 1826 où il assiste à la représentation de pièces de Shakespeare, ce sera sa chère Italie qu'il ne quittera guère, « morceau de ciel tombé sur la terre » dira-t-il, sauf en 1938 pour l'Espagne, l'Italie où il sera "Monsieur le Consul" jusqu'en 1841. [2] Il en donnera sa propre dans ses écrits, des récits de voyage où l'écrivain prend le pas sur le témoin, où dans Promenades dans Rome, où la réalité est revisitée par l'esprit stendhalien.
Après un crochet par le Bordelais et la Provence en 1829, il revient en France en 1837 avec un autre écrivain Prosper Mérimée, dans la France "louis-philipparde", pérégrinations qu'on retrouve dans un autre texte intitulé Mémoires d’un touriste qui fait entrer ce néologisme dans la langue française.
Il s'intéressait aussi ben aux gens qu'il avait l'occasion de
rencontrer au cours de ses voyages qu'à l'environnement qu'il
découvrait, « J’aime les beaux paysages, écrivit-il.
Ils font quelquefois sur mon âme le même effet qu’un archer bien manié
sur un violon sonore; ils augmentent ma joie et rendent le bonheur plus
supportable. »
2- STENDHAL : Rome, Naples et Florence
« Mes voyages en Italie me rendent plus original, plus "moi-même". J'apprends à chercher le bonheur avec plus d'intelligence. » [3]
Ce n'est pas tant le récit du voyage qui intéresse Stendhal que l'art, surtout l'art italien si prisé à son époque, l'opéra, l'architecture et la peinture en particulier... [4] ainsi que les femmes. [5] Quelques annotations suffisent à une description : « le caractère de la beauté en Italie, c’est le petit nombre des détails et, par conséquent, la grandeur des contours,» une simple touche comme lors de son arrivée à Florence : « Enfin,
à un détour de la route, mon oeil a plongé dans la plaine, et j’ai
aperçu de loin, comme une masse sombre, Santa Maria del Fiore et sa
fameuse coupole, chef-d'œuvre de Brunelleschi, » une simple réflexion à propos de Milan et Bologne : « Bologne a, ce me semble, beaucoup plus d’esprit, de feu et d’originalité que Milan ; on y a surtout le caractère plus ouvert. »C'est d'abord l'opéra qui l'attire (et les belles femmes qui y paradent) : « je vais dans huit ou dix loges; rien de plus doux, de plus aimable (...) Chaque femme est en général avec son amant. »
 Santa-Maria del Fiore
Santa-Maria del Fiore
Dans sa quête de l'art dans ses formes classiques, il est servi en Italie et il constate que « la France n’a rien produit de comparable. » Il suffit de regarder, de se laisser aller car « il ne faut pas des raisonnements pour trouver cela beau. Cela fait plaisir à l’œil.» Il est insatiable allant d'un lieu à l'autre, d'un musée à un autre, ouvert à l'émotion offerte par exemple « en sortant de Santa Croce, j’avais un battement de cœur; la vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber. » Ce que certains ont appelé « le syndrome Stendhal. »

Vue de la place du Grand-Duc à Florence, Canella, 1847
3- STENDHAL : Promenades dans Rome
A partir de ses souvenirs, Stendhal nous entraîne à la découverte de Rome
et des romains. Ce ne sont pas les souvenirs qui manquent : première
visite en 1802, en 1811 pendant l'occupation française et dans une
ambiance "napoléonienne" qui lui déplaît fort, successivement en 1816,
1817 et 1823 avec le très aimable cardinal Consalvi. En 1828, changement de tonalité, le climat s'est encore détérioré on pouvait « recevoir des coups de bâtons sur un "cavalletto". »
Il annonce carrément qu'il dira toute la vérité, librement, reprenant
les anecdotes qui lui ont le plus marqué. Entre le récit de voyage et le
récit personnel -il parle à la première personne- « il fait éclater le journal de voyage en prenant la liberté de parler de ce qu’il veut, et quand il le veut. » [6]
Il voyage écrit-il « pour voir des choses nouvelles, non pas des peuplades barbares comme le curieux intrépide qui pénètre dans les montagnes du Tibet, ou qui va débarquer aux îles de la mer du Sud.» Il nous présente la Rome multiple : la romaine avec de nombreux commentaires sur les ruines de l’Antiquité; la ville dédiée à l’Art,
avec ses monuments qui illustrent tous les époques, véritables cours
d'histoire à livre ouvert, avec les chefs-d’œuvre de la peinture et de
la sculpture; enfin la cité des Papes, et le « gouvernement et les mœurs qui en sont la conséquence. » Stendhal nous offre aussi plusieurs menus des visites à effectuer, le choix entre le Colisée et les Raphaël du Vatican, le Panthéon et l’atelier de Canova par exemple... selon l'humeur du touriste, ce qu'il recherche entre « le "beau inculte et terrible" ou le "beau joli et arrangé", faites-vous conduire au Colisée ou à Saint-Pierre. »

Attention cependant nous prévient-il, de ne pas vouloir "tout voir", d'être atteint du « dégoût de l’admiration » et il veut mieux alors aller se distraire avec les Romains sans toutefois ajoute-t-il ironique, «se brouiller avec sa cour et sans déplaire au pape. » Dans cette Rome soumise à l'imagination de Stendhal, il fait aussi œuvre didactique, incluant une documentation intéressante sur la ville où l'art, l'histoire romaine et la papauté tiennent une place importante, tout comme les descriptions, les conditions de son voyage à une époque où il fallait souvent compter une quinzaine de jours pour parcourir la distance entre Paris et Rome.
Curieusement, ces "promenades romaines" nous entraînent aussi -comme son livre précédent "Rome, Naples et Florence" (voir article ci-dessus)- dans ces deux dernières villes. Il se réconcilie avec Naples, le théâtre San Carlo où chante le grand Lablache et il est transporté par Florence, même s'il trouve ses habitants "trop français", artificiels et prétentieux. C'est à Florence qu'il rencontre Lamartine, alors secrétaire à la Légation de France, rencontre heureuse qui lèvera bien des préventions entre les deux écrivains.
Ceci dit, la trame d'un guide nommé Stendhal qui entraîne un groupe à la découverte de Rome est purement imaginaire. A la date supposée du départ de la visite le 3 août 1827, il est à Gênes où il rencontre Manzoni et non à Rome et personne n'a trouvé trace de l'épigraphe qu'il attribue à Mercurio dans le Roméo et Juliette de Shakespeare : « J'ai vu de trop bonne heure la beauté parfaite... » C'est en fait du pur Stendhal !
4- STENDHAL : Chroniques italiennes
Chroniques italiennes est un recueil de récits de Stendhal, composé de huit récits [7] écrits entre 1836 et 1839, qui s'appuient sur de vieux documents que Stendhal exhuma quand il était consul de France dans le petit port tyrrhénien de Civitavecchia.
Trop de faveur tue L'abbesse de Castro Vanina Vanini & La duchesse de Paliano
Cet ensemble de récits qui datent de la Renaissance, sont marqués au sceau de la violence et de la passion, donc d'un romantisme, imprégnant les textes de Stendhal. Après être parus dans la Revue des deux mondes, ils seront réunis en recueil auquel s'ajoutera La Duchesse de Palliano ainsi que deux œuvres posthumes, Trop de faveur tue et Suora Scolastica. C'est son cousin Romain Colomb, son exécuteur testamentaire, qui imposa le titre de « Chroniques italiennes » pour la réédition de 1855.
De ces huit récits, les plus connus sont certainement "Vanina Vanini" et "La Duchesse de Palliano" mais d'autres méritent aussi d'être présentés . Vanina Vanini narre l'histoire de Pietro Missirilli, un carbonaro qui réclame la liberté pour son pays, et de Vanina, jeune princesse orgueilleuse. Son père veut la marier à un prince, Don Livio Savelli mais Vanina refuse cette union, éprise du beau carbonaro blessé d'un coup de poignard, que son père héberge dans sa demeure romaine. Mais, jalouse de l'engagement patriotique de Livio parti en Romagne, elle dénoncera ses amis et lui par solidarité se livrera avec eux. Vanina, torturée par la culpabilité, et emprisonnée et rejetée par Livio qui finira cependant par succomber à ses charmes.
Vittoria Accoramboni a tout pour elle, la beauté, la naissance, le charme... et est très heureux après son mariage avec Félix Peretti. Mais Félix est mystérieusement assassiné en pleine rue de trois coups d’arquebuse. On soupçonne quand même le prince Orsini qui aurait même pu agir avec le consentement de la famille de Vittoria. Soupçon augmenté le jour où elle épouse le prince Orsini alors que le frère de Félix, le cardinal Montalto, devient pape sous le nom de Sixte-Quint. Le dénouement sera tragique : après le décès du prince, Vittoria et ses frères sont assassinés par le frère du prince Louis Orsini, jaloux que Vittoria hérite; mais il sera finalement emprisonné puis étranglé.
Les Cenci
François Cenci est un don Juan fortuné et renommé pour son courage. Après le décès de sa première femme, malgré ses sept enfants, il épouse Lucrèce Pétroni. Mais c'est un violent qui bat sa femme comme ses filles, en particulier Béatrix Cenci victime d'une tentative de viol. A la maison, le climat devenant irrespirable, Béatrix et sa mère aidées de deux hommes tuent François Cenci, Béatrix parvenant à faire croire à un accident. Mais la police papale veille et les deux femmes finissent par passer aux aveux. Malgré l'aide de plusieurs cardinaux seul le plus jeune des frères sera sauvé. Elles monteront à l'échafaud avec une dignité telle qu'elles forcent l'admiration de leurs concitoyens.


Béatrice Cenci 1599 par Guidi Reni par Harriett Hosmer (1857)
La Duchesse de Palliano
Jean-Paul Carafa, avec l'aide de son cousin Olivier Carafa, est nommé pape sous le nom de Paul IV. Rapidement, il nomme ses trois neveux à des postes d'importance, l'un d'eux le duc de Palliano, marié à Violante de Condone, très belle et très orgueilleuse. Les deux autres neveux ne sont pas mieux et le pape, lassé de leurs incartades, se résout à les chasser. Sur ces entrefaites, la duchesse prend un amant, un nommé Marcel Capece mais sa suivante, par vengeance, raconte tout au duc. L'imbroglio vire à la tragédie quand le duc exécute l'amant de sa femme et sa suivante qui avait dévoilé l'affaire, et devant l'insistance de son entourage, finira par se résoudre à faire supprimer la femme adultère. Le nouveau pape Pie IV fait mettre à mort le duc et son frère cardinal mais son successeur Pie V réhabilitera leur mémoire.
L’Abbesse de Castro
La campagne autour de Rome, la charmante ville d'Albano en 1542 où vit la puissante famille des Campireali.
Hélène de Campireali est renommée pour sa beauté exceptionnelle. Comme dans les contes, elle est courtisée clandestinement par Jules Branciforte, pauvre brigand qui lui envoie un bouquet qui cache un mot d'amour. Malheureusement, il est démasqué par le père et le frère d’Hélène mais il réussit à renouer avec la jeune fille, lui avouant sa modeste condition.
Au cours des luttes pour le pouvoir qui opposent les deux familles les plus puissantes de Rome, les Colonna et les Orsini, Jules est amené à tuer Fabio Campireali le frère d'Hélène, tandis qu’Hélène a été expédiée au couvent de Castro . Situation cornélienne s'il en est. Hélène finira par lui accorder son pardon et il essaiera de l'enlever du couvent où elle est fort bien gardée, mais blessé pendant sa tentative, il échouera.
Hèlène s'enfuit alors du couvent, déguisée en ouvrier mais Jules, pourchassé, menacé de mort, s'est embarqué pour Barcelone. Le croyant mort, elle retourne au couvent et parvient à en devenir l'abbesse. Mais Hélène commet une terrible imprudence et tombe enceinte de l'évêque, Francesco Cittadini. Accouchement clandestin bien sûr mais elle sera dénoncée par la sage-femme, condamnée par l'impitoyable cardinal Alexandre Farnèse, pape sous le nom de Paul III et tentera de s'évader par un passage souterrain. Tandis que Jules revient d'Espagne après la mort du pape, bénéficiant d'une période de vacance du pouvoir, [8] elle tire les leçons de son inconduite et il arrive trop tard, la trouve morte, « la dague dans le cœur ».
5- STENDHAL : Mémoires d'un touriste
Ce chapitre complété a été déplacé à l'adresse suivante :Mémoires d'un touriste & Voyage dans le mid
6- STENDHAL : Histoire de la peinture en Italie (en complément)
Curieux parcours que ce livre paru anonyme et à compte d'auteur, réécrit après que Stendhal eût égaré son manuscrit pendant la campagne de Russie. Livre prétexte diront certains, à une réflexion politique après la débâcle de Napoléon en Russie, amour de l'Italie diront quelques autres, Italie qui en l'occurrence s'appelait Angela Pietragrua, la belle Milanaise qui lui valut des amours passablement tourmentées.Cet ouvrage, écrit entre 1812 et 1816, mêle en effet souvenirs personnels, histoire et développements artistiques. Il y commente des œuvres de Guido Reni ou Le Corrège mais s'attarde surtout sur Léonard de Vinci et Michel-Ange. [9]
Différentes éditions de son essai
Partant des primitifs, son parcours est sans grande cohérence, intéressant quand même à une époque où on manquait de documentation sur ces questions. Il y développe cependant ses conceptions sur l'art, en particulier la relativité du concept de beauté en art, cette distinction importante entre les notions de «Beau moderne» et de «Beau idéal», qu'il reprendra dans la querelle du romantisme.
Notes et références
[1] Jean Lacouture, "Stendhal, le bonheur vagabond", éditions Le Seuil, janvier 2004
[2] Voir ses "Souvenirs d'égotisme" que Stendhal écrivit quand il était consul à Civitavecchia, Flammarion, collection GF, 204 pages, 2013
[3] Stendhal, "Rome, Naples et Florence", illustrés par les peintres du romantisme, éditions Diane de Selliers, 2002
[4] Voir Stendhal, "Histoire de la peinture en Italie", Gallimard, collection Folio essais, 720 pages, 1996
[5] La beauté est pour lui «pleine d’âme et de feu», écrit-il dans "Promenades dans Rome" à propos des jolies femmes de Rome remarquées la veille au soir au concert.
[6] Préface à "Promenade dans Rome" par Michel Crouzet, Gallimard, Folio classique, 1997
[7] Chroniques italiennes : Vittoria Accoramboni, Les cenci, La Duchesse de Paliano, L'Abbesse de Castro, Trop de faveur tue, Suora Scolastica, San Francesco a ripa, Vanina Vanini, 1837-1839
[8] Paul III meurt le 10 novembre 1549 alors que Jules III son successeur, ne sera élu que le 7 février 1550
[9] Stendhal, "Histoire de la peinture en Italie", éditions Gallimard, établie par Vittorio del Litto, Folio-essais, 720 pages, 1996
Voir l'ensemble de mes fiches sur Stendhal :
* Stendhal, « Un européen absolu »
* Stendhal et La découverte de l'Italie -- Stendhal et La campagne de Russie --
* Stendhal : Armance -- Stendhal : Lamiel -- Stendhal : Lucien Leuwen
* Stendhal consul à Civitavecchia -- Stendhal : Mémoires d'un touriste
* Vie de Henri Brulard -- Stendhal à Lyon, C. Broussas
Autres références
* Beyle, Stendhal, Brulard, Le rouge et le noir, La chartreuse de Parme, Stendhal à Grenoble et à Paris
* Présentation générale des œuvres de Stendhal
<<< Christian Broussas -Stendhal voyageur - 11/2013 maj 2014 >>>