Référence : Annie Ernaux, L'écriture comme un couteau, interview Frédéric-Yves Jeannet, éditions Stock, 2003 et éditions Gallimard/Folio, 148 pages, 27 octobre 2011.
Édition augmentée d'une postface inédite d'Annie Ernaux.

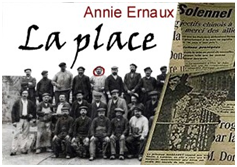
« Un jour, avec un regard fier : Je ne t'ai jamais fait honte »
Introduction
Ce couteau qu’Annie Ernaux veut
brandir comme un peintre se coltine avec la matière pour dispenser ses
touches de couleur comme un manifeste, c’est sa façon d’écrire, son
style sec, direct pour dire l’essentiel.
Elle se sert d’elle, de sa
propre histoire pour publier son manifeste d’écrivaine, retrouver cette
écriture directe absente de toute image, de toute figure de style qui a
marqué le temps de ses études puis le début de son métier d’enseignante,
pour retrouver la fraîcheur du style populaire qu’elle a connu dans sa
jeunesse.
Deux écritures, deux mondes, l’impression d’être assise entre deux chaises, de générer ce malaise qu’elle nomme sa honte.
Ses deux formes d'écriture
Le
langage de la bourgeoisie n'est pas le sien, trop châtié, trop
contourné, le sien est relié au langage populaire de sa jeunesse : « J'importe
dans la littérature quelque chose de dur, de lourd, de violent même,
lié aux conditions de vie, à la langue du monde qui a été complètement
le mien jusqu'à dix-huit ans, un monde ouvrier et paysan.
Toujours quelque chose de réel. J'ai l'impression que l'écriture est ce
que je peux faire de mieux, dans mon cas, dans ma situation de
transfuge, comme acte politique et comme "don". »
Dans ce livre d'entretiens avec Frédéric-Yves Jeannet, l'autrice parle de son approche de l'écriture, des raisons de s'y consacrer et de sa façon de travailler.
Son rapport à l'écriture est complexe,
"consubstantiel à son vécu", extérieure à elle-même, « quelque chose
d'un ordre immatériel et par là même assimilable, compréhensible au sens
le plus fort de la "préhension" par les autres. » Elle y aborde de nombreux thèmes dont l'écriture du moi, la forme, le style, les influences, la dimension politique de l’écriture...
Contrairement à Anaïs Nin dans son Journal, elle affirme que « le Journal intime lui paraît le lieu de la jouissance, que les autres textes sont celui de la transformation. J'ai plus besoin de transformer. »
Le "je" dans son écriture
Elle dit être vouée au "je", « parce que, à l’intérieur de ce cadre fictionnel, je procède à une anamnèse [1] de ma propre déchirure sociale : petite-fille d’épiciers-cafetiers, allant à l’école privée, faisant des études supérieures. » (p 27)
Elle peut s’imposer ou se mettre en retrait par rapport au narratif : « Je n’ai effectivement pas la même voix dans Les Armoires vides ou dans L’Événement. » C’est La Place qui marque ce tournant dans sa manière d’écrire, aussi bien par rapport à la voix qu’à l’acte lui-même d’écrire. (p 31)
L’Écriture comme un manifeste
L’écriture qui lui parle reflète uniquement la réalité, sans aucun sentiment, sans aucun artifice, ce qu’elle nomme dans La Place l’écriture plate, « celle-là même que j’utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles.
» Mots et phrases servent à donner corps aux choses, à être « une
écriture du réel. » (p. 34-35) En ce sens, elle se réfère souvent à
cette phrase de Brecht : « Il pensait dans les autres et les autres pensaient en lui. » (p. 44)
Dans « L’Événement » par exemple, qui relate son avortement, le titre donne le ton. Il ne s’agit pas de témoignage, d’un texte sur une expérience féminine, un fait de société, il s’agit d’une expérience mémorielle et narrative et la relation entre les deux. (p. 92)
Écrire sa vie, vivre son écriture
Elle
dit sentir l’écriture comme un phénomène de mutation de son vécu,
éminemment intime, en quelque chose d’extérieure à elle-même,
immatérielle et qu’on peut ainsi mieux appréhender, mieux comprendre.
C’est le cas pour L’Occupation, les relations avec son amant, où « je sens, je sais… que ce n’est pas ma
jalousie, c’est-à-dire quelque chose d’immatériel, de sensible et
d’intelligible, que les autres pourront peut-être s’approprier. »
Ce phénomène de mutation ne va pas de soi, il est généré par l’écriture,
la traque d’une vérité hors de soi, une vérité au-delà de soi, plus
importante qu’elle-même et ce qu’on pourra penser d’elle. Ainsi, « elle
mérite, elle exige que je prenne des risques… et c’est peut-être une
façon de dépasser le paradoxe. » (p. 103)
Elle cite Proust qui dit que « la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature. » Pour elle, l’écriture c’est « découvrir en écrivant ce qu’il est impossible de découvrir par tout autre moyen, parole, voyage, spectacle, etc. Ni la réflexion seule. Découvrir quelque chose qui n’est pas là avant l’écriture. C’est là la jouissance – et l’effroi – de l’écriture, ne pas savoir ce qu’elle fait arriver, advenir. » (p. 136)
Notes et références
[1] Anamnèse : "faire remonter des souvenirs" (d'un patient)
Voir aussi :
* Annie Ernaux, Le vrai lieu -- Mémoire de fille – La place -- Les Années --
* Annie Ernaux à Cergy -- AE chantre de l'autofiction --
* L'art d'écrire --
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire