Référence :
Annie Ernaux et Rose-Marie Lagrave, La conversation, éditions EHESS,
collection Autobiographie, postface Paul Pasquali, 144 pages, mars 2023
Aux frontières de la littérature et de la sociologie
/image%2F0404379%2F20250415%2Fob_6ee8c5_ernaux-une-convercation.jpg)
Un dialogue entre la romancière Annie Ernaux et la sociologue Rose-Marie Lagrave [1],
même génération, confrontant leur trajectoire sociale. Des points
communs, familles modestes, normandes, catholiques mais un rapport
différent à la notion de « transfuge de classe. » Elles parlent de
parcours, leurs lectures (de Bourdieu à Virginia Wolff), leur rapport au travail à la vieillesse, conçoivent l’amitié féminine et l’écriture comme moyens d’émancipation.
Elle cite par exemple Nicole Loraux et Michelle Perrot, le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, les écrits de Rose-Marie Lagrave et Élise ou La Vraie Vie de Claire Etcherelli.
Leur connivence est ancienne puisque Annie lisait les articles que publiait Rose-Marie dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales fondée par Bourdieu tandis que Rose-Marie dévorait tous les ouvrages d’Annie. [2] Leur pensée se rejoignait sur les relations entre sociologie et littérature, sur une socioanalyse qui fait que "l’écriture de soi puisse déboucher sur une connaissance de soi."
Elles sont d’abord liées par une grande proximité : milieu rural
normand, mariage, maternité et divorce, engagement féministe,
réfléchissant sur les liens entre classe et genre, la mobilité sociale,
la notion de transfuge ou disent-elles, de « transclasse ».
Ce que Annie Ernaux traduit ainsi :
« Je ne connaissais pas le terme “transfuge de classe” lorsque j’ai écrit Les Armoires vides en 1974. C’est seulement dix ans plus tard, à la sortie de La Place, que… j’ai découvert l’expression et ce qu’elle recouvrait. »
Expression qu’elle a adoptée en
ajoutant qu’elle n’était pas du genre à trahir parce qu’elle contient
l’idée d’une forte volonté mais le mot "transfuge" ne s’adresse
nullement « ni au temps ni aux
influences et pas davantage aux hiérarchies sociales et culturelles. On
ne peut être "traitre" quand on obéit aux pressions de la société pour
parler de telle manière, lire tel livre et qu’on se détache de son
milieu familial. » Elle pense qu’il vaudrait mieux utiliser le terme "transclasse" [3] qui désigne aussi bien le déclassement que l’ascension sociale. (p. 89).

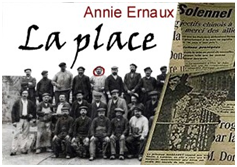
Ça n’empêche nullement qu’elle s’est longtemps sentie coupable de trahison avec sa classe et sa famille. « Mais
ajoute-t-elle « Je l’éprouve moins aujourd’hui parce que j’écris.
C’était le vœu de ma jeunesse, “j’écrirai pour venger ma race !” Encore
fallait-il que le contenu et la forme des livres ne s’éloignent pas de
ce but. Que l’écriture transmette l’expérience du premier monde, de la
façon la plus directe possible. Il se trouve que mes livres ont
rencontré d’autres consciences, ont permis l’émergence de choses
enfouies ou indicibles. S’il y a trahison, c’est ainsi, en écrivant, que
je la rachète… »
Pour sa part, Rose-Marie Lagrave n’a « jamais eu l’impression d’avoir trahi [s]a classe », comme elle l’explique : « je
n’en suis pas totalement sortie ; elle m’habite encore par toutes
sortes d’adhérences. […] Mes engagements et convictions politiques m’ont
préservée de ce sentiment de trahison. »
Participer à des luttes en faveur
des classes "subalternes" lui a permis de racheter sa trahison supposée,
de payer sa dette au milieu rural qui était le sien. « Cela
suppose de ne pas se laisser prendre par les hauteurs de vue qui sont
des hauteurs de classe de la bourgeoisie, à laquelle maintenant
j’appartiens objectivement, et dont je récuse les valeurs et les
comportements. »
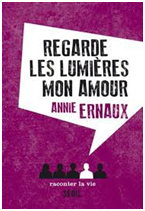
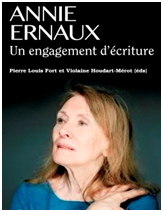
Une conversation particulièrement enrichissante
Annie Ernaux revient sur son métier d’enseignante qu’elle a rarement évoqué :
« J’ai cherché à sortir d’une représentation élitiste de la
littérature, à former des gens qui n’arriveraient pas devant leurs
classes avec la seule idée qu’ils avaient des chefs-d’œuvre à
transmettre, mais avec celle de rendre des textes vivants, actifs,
auprès des élèves, ce qui suppose de mesurer la distance qui en sépare
certains. »
Cette carrière de prof, facilitée par le télé-enseignement, lui a évité
d’écrire un livre par an ou de chercher d’autres sources de revenu peu
gratifiantes. Ça lui a permis d’être préservée des aspects matériels.
Vision littéraire idéaliste précise-t-elle mais lui permettant de
travailler sur la forme et lui donnant une grande liberté quant au
contenu.
Elles évoquent aussi les livres qui les ont marquées, leur ont permis d’évoluer ou de la vieillesse, comme Rose-Marie Lagrave qui parle du choix du moment de sa mort, de mourir dignement, rappelle leur lutte pour l’IVG, revient à Annie en écrivant : « Tes
livres avaient déjà commencé à jeter un trouble, mais à présent me
voilà persuadée qu’il faut… fouiller ma mémoire et oser écrire quoi
qu’il en coûte. Et tu m’as refilé en douce cette certitude, non en
faisant ta pédagogue, mais par le seul miracle de l’échange amical. »
Leurs interactions sont fort anciennes, « quand j’ai lu La Femme gelée, dit Rose-Marie, j’avais l’impression de lire, à style nu, ma vie du moment. » Inversement, le livre de Rose-Marie Se ressaisir... sur la notion de transfuge de classe féministe a renforcé les réflexions d’Annie qu’elle avait initiées après ses lectures de Pierre Bourdieu. (La distinction, 1979)
Elle intègre les apports de sciences sociales et pratique une autoanalyse des épisodes de sa vie. De son côté, Rose-Marie a recours à l’autographie et l’usage du « je », voulant comme Annie se faire « ethnologue de soi-même. » (p. 72)
Autour du concept de Bourdieu "d’habitus clivé" [4], elles analysent aussi cet écartèlement, ce qu’Annie Ernaux
définit comme l’impression d’être « coupée en deux » (p. 80, avec ce
ressenti de trahir sa classe, comme on l’a déjà vu, sentiment que ne
partage pas Rose-Marie qui parlerait plutôt d’adaptation.
Elles se rejoignent pour noter la condition particulière des femmes dans le processus de transfuge, comme l’exprime Annie Ernaux : « les
femmes ne subissent pas de la même façon la domination masculine, ne
vivent pas leur condition selon leur classe sociale, selon qu’elles sont
ou non racisées. » (p. 52).
Elles se rejoignent aussi sur le thème de la vieillesse, le corps comme
force de travail et source de l’intime, ainsi que sur les combats qui
restent à mener, comme selon Annie Ernaux, celui de l’euthanasie. (p. 114)
Notes et références
[1] Rose-Marie
Lagrave, née en 1944, est directrice d’études à l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales (EHESS). Elle a publié en particulier des
études sur les villages ruraux ou la notion de transfuge social.
Auteure de Se ressaisir. Enquête autobiographique d’une transfuge de classe féministe en 2021.
[2] En particulier, le premier livre d’Annie intitulé Les
armoires vides, paru en 1974, dans un contexte marqué par les luttes
féministe comme sa participation au MLAC (Mouvement pour la libération
de l’avortement et de la contraception).
[3] Voir Chantal Jaquet, Les transclasses ou la non-reproduction, Paris, PUF, 2014
[4] Voir Pierre Bourdieu, Esquisse pour une auto-analyse, Paris, Raisons d'agir, 2004
Voir aussi :
* Annie Ernaux, Le vrai lieu -- Mémoire de fille – La place -- Les Années --
* Annie Ernaux à Cergy -- AE chantre de l'autofiction --
* L'atelier noir -- L'écriture comme un couteau --
* L'art d'écrire --
---------------------------------------------------------------------
<< Christian Broussas • La conversation © CJB °15/04/2025 >>
---------------------------------------------------------------------
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire