Référence : Ruth Fivaz-Silbermann, La fuite en Suisse, préface de Serge Klarsfeld, coédition Calmann-Lévy/Mémorial de la Shoah, 1448 pages, novembre 2020
Les Juifs à la frontière franco-suisse durant les années de « la Solution finale »
Itinéraires, stratégies, accueil et refoulement.
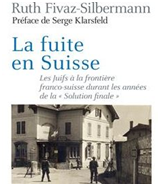

Ruth Fivaz-Silbermann
« La Suisse aurait dû accueillir tous les Juifs à partir de 1942. » Ruth Fivaz-Silbermann
Ce "pavé" est le fruit d'une thèse qui renvoit aussi à sa propre histoire familiale. Il est basé sur un ensemble d'archives suisses sur les réfugiés, de dossiers préfectoraux français et de documents issus d'organisations d’entraide mais l'histoire de ses patents a aussi pesé lourd sur sa décision d'entreprendre ce travail.


Photos de réfugiés juifs
C'est l’Anschluss en 1938 qui pousse ses parents Mary et Victor Silbermann à fuir Vienne. La moitié de la famille ne reviendra pas des camps mais ses parents parviendront à obtenir un visa du consul de Suisse à Venise et se retrouve à Zurich. Tous deux sont alors internés au camp de Girenbad près d’Hinwil. Libérés, ils s'installent à Zurich où son père fait des traductions clandestines pour vivre.
En 1945, ils parviennent à obtenir le droit d’asile (sur quelque 65 000 réfugiés, seuls 2000 l'ont obtenu) et s'installent à Genève.

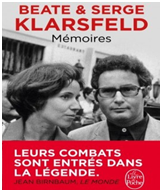
À l’été 1942, « la Solution finale de la question juive » se met en place en France. Beaucoup de Juifs qui n'avaient pas encore pris la mesure de la menace, tentent de fuir en Suisse,
solution qui paraît la plus simple, en traversant si possible la zone
libre. Mais beaucoup d'entre eux seront arrêtés et déportés.
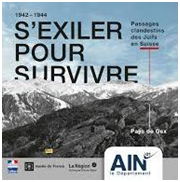

L’exposition au musée de la Résistance et de la déportation à Nantua (01)
La Suisse,
peu favorable à cet afflux de population, entrouvre néanmoins ses
frontières avec une certaine mauvaise volonté. Les chiffres reflètent
bien la situation : quelque 12 500 Juifs venus de France y sont effectivement accueillis mais près de 3 000 sont refoulés et largement mis en danger.
(
En frontière de la zone occupée par exemple, le taux de déportation est
50%, une personne sur deux n'ayant pas réussi de survivre à son
refoulement)


On
y suit le fonctionnement des réseaux, payants ou bénévoles, des
passeurs, l'essor des réseaux de la résistance juive de plus en plus
présents en Suisse.
On y rencontre des Juifs qui se décident à prendre la fuite après l'exécution de la "solution finale", le personnel qui a participé à la politique d’extermination, les dirigeants suisses et les politiques qu'ils ont suivies.


Enfants juifs réfugiés La frontière de St Gingolf en avril 1943
Ruth Fivaz-Silbermann estime que la Suisse a pratiqué une politique restrictive en n’autorisant l’entrée dans le pays qu’aux personnes avec visa ou sous protection des Conventions de La Haye. « Officieusement
néanmoins, dès l’été 1942, une politique d’urgence plus souple a été
appliquée sous la pression de l’opinion publique et des lobbys
pro-réfugiés », écrit-elle. Des instructions de tolérance ont été émises et la Suisse a accueilli au total quelque 22 000 juifs pendant la guerre. »
Elle ajoute qu'aucun des 4000 refoulements enregistrés sur l’ensemble
de la frontière helvétique ne lui semble vraiment justifiable.
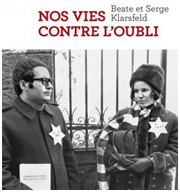

Camion de maquisards à Divonne 01
S'exiler pour survivre
Quelque trois cent soixante-cinq juifs sont passés de France en Suisse entre 1942 et 1944. C'est peu par rapport à la Haute-Savoie. Treize
voies de passages (ou “spots”) ont été identifiées. Une fuite à
l'issue parfois malheureuse : « Certains fugitifs ont été arrêtés et
déportés. » D'autres comme la famille de Paul Mandel, ont eu plus de chance.
/image%2F0404379%2F20250925%2Fob_f40214_expo-ferney-1.jpg)
/image%2F0404379%2F20250925%2Fob_9aa7b0_les-parents-paul-mandel.jpg)
Ce couple belge, Samy et Hélène Moszkowiez vel Mandel, ont fui leur pays en juin 1942, munis de faux papiers d’identité belges et d’une carte Michelin. Ils passent par les Ardennes, Besançon, puis arrivent à Gex en car, par le col de la Faucille. De Bellegarde, par le tain, Ils gagnent le village de Saint-Jean-de-Gonville, à 2 km de la frontière. Le pont frontière sur la Roulave étant gardé, ils se glissent en contrebas.
Un habitant leur indique à quelle heure les douaniers allemands prennent
leur pause à l’auberge et "leur coupe les barbelés." C'est ainsi qu'il
parviennent à rejoindre Genève. Ils parviendront à faire venir en Suisse leur oncle Wölfi et leur tante Rachel mais Blirne et Salomon, les parents d’Hélène, eux, se font arrêter. Mais lui s’échappe et réussit finalement à faire évader sa femme.
Happy end.
/image%2F0404379%2F20250925%2Fob_fef6ee_vivre-et-survivre.jpg)
/image%2F0404379%2F20250925%2Fob_d230ad_s-exiler-pour-survivre-fort-l-ecluse.png)
Fort L'écluse 2022
Voir également
* Reportage FI -- Vidéo Nantua -- Nantua 2019 --
* Voir mon site Autour de l'histoire, Le XXe siècle --
------------------------------------------------------------------------------------
<< Ch. Broussas, La fuite en Suisse 08/12/2020 © • cjb • © >>
------------------------------------------------------------------------------------
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire