Référence : JMG Le Clézio, Avers, "Des nouvelles des indésirables", éditions Gallimard, Collection Blanche, 224 pages, 2023
« Le Clézio réaffirme la valeur inestimable de chaque être, particulièrement des plus déshérités d’entre eux. Émouvant. » Le Monde
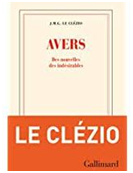

JMG Le Clézio aime bien écrire des nouvelles, que ce soit des "novellas", ces grandes nouvelles qu’on retrouve dans des recueils comme Hasard, Tempête ou Chanson bretonne [1] ou ces ensembles de courts textes présents dans par exemple Mondo et autres histoires ou La ronde et autres faits divers. [2]
Dans
ce recueil, il nous propose huit textes qui ont en commun des
personnages en rupture avec les sociétés occidentales, en recherche
d’identité, des indésirables comme il les nomme,
condamnés à l’oubli ou à la disparition. Ils symbolisent des valeurs qui
n’ont plus cours, le goût de l'aventure, du rire, de la poésie. Mais
c’est bien de leur survie dont il s’agit ici.
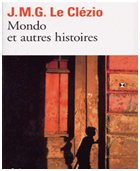
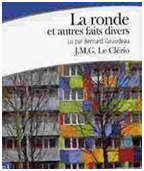
Le Clézio avait déjà abordé ce thème des "invisibles" dans une nouvelle intitulée Fantômes dans la rue publiée en 2000 et reprise dans ce recueil. « On passe à côté d'eux, écrivait-il, souvent sans leur jeter un regard… Exclus, fugueuses, errants, immigrés sans racines… »
Dans une de ses nouvelles, il part de son expérience, d'une vieille chanson venue de l'île Maurice, qu'il retrouve du côté de Nice pendant la guerre. « En passant la rivière Taniers, j'ai rencontré une vieille femme… » [3] Il se rappelle cette chanson créole que fredonnait Yaya, fille d’esclave de l’île Maurice. Sa grand-mère aussi la chantait « pour traverser la guerre » disait-elle, dans la cave d’une maison varoise où ils s’étaient réfugiés pendant la guerre pour être à l'abri des bombes. [4]
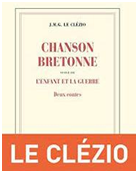
« Pourquoi
les berceuses sont-elles souvent tristes? Est-ce parce que… la vie est
dure et mauvaise, violente, terrible ou bien parce que la porte du
sommeil s’ouvre sur les cauchemars, sur la solitude ? »
Le Clézio nous donne des indications sur son propos, sans doute pour que tout soit bien clair dans sa démarche d’écrivain : « Pour
moi, précise-t-il, l’écriture est avant tout un moyen d’agir, une
manière de diffuser des idées. Le sort que je réserve à mes personnages
n’est guère enviable, parce que ce sont des indésirables, et mon
objectif est de faire naître chez le lecteur un sentiment de révolte
face à l’injustice de ce qui leur arrive. »
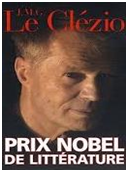

Derrière ce mot d'indésirable, se trouve tout ce qui tourne autour des problèmes de l'exclusion, du viol et de la guerre auxquels Le Clézio
oppose les beautés naturelles. On retrouve ce contraste dans la
première nouvelle, la plus importante, qui conte la vie d'une jeune
orpheline qui parvient à dépasser une condition peu enviable pour
espérer malgré tout.

« Pourquoi inventer des personnages, des histoires? Est-ce que la vie n'y suffit pas ? » page 130
À l'image de cette première nouvelle Avers qui sert de titre à ce recueil [5], Le Clézio veut nous faire partager la terrible existence d'enfants qui luttent pour leur survie. Certains comme Chuche et Juan errent jusqu'à trouver un havre de paix [6] ou les fantômes dans la rue [7], Renault le clochard perdu dans la grande ville, Aminata
qui malgré sa vie compliquée aide les autres, comme son amie qui sauve
la petite voleuse, tous ceux qu'on ne voit pas, ces "ectoplasmes" qui
errent dans Paris, dans le métro...
D'autres se glissent dans les égouts reliant le Mexique aux États-Unis [8] ou vont être maltraités le long d'un grand fleuve d'Amérique du Sud. Et bien sûr, la guerre accentue encore les problèmes, dans un quelconque pays du Moyen-Orient où les terribles difficultés qu'ils rencontrent se mêlent à la solidarité.
Il y a aussi ceux qui ne supportent pas la séparation, comme dans L'amour en France (p 135-142), le manque d'Oriya et de leurs enfants. Dans les dernières nouvelles il y a Yaya, la nounou mauricienne et l'histoire d'une tribu indienne Etrebbema, belle société dite primitive anéantie par les narcotrafiquants. Et la guerre bien sûr avec Hanné la fillette sourde muette et deux jeunes ados libanais Marwan et Medhi, réfugiés palestiniens fuyant la guerre à la recherche improbable d'une terre d'asile. [9]


JMG Le Clézio nous donne à voir tous ces invisibles qui peuplent le monde... et ils sont si nombreux. On rencontre ainsi la misère à Rodrigues, une île qu'il connaît bien, à proximité de Maurice, les jeunes traqués entre le Pérou et le Brésil, les terribles conditions de vie des travailleurs marocains ou des indiens du Panama
confrontés aux narcotrafiquants, la divagation de deux palestiniens
fuyant la guerre. Autant d'exemples qui pourraient être multipliés à
l'infini.
Complément : un thème central
Ce thème d'un monde de technique et
d'urbanisation forcée qui brime et oppresse l'être humain est récurrent
et même central chez Le Clézio, puisqu'on le rencontre
tout au long de son œuvre. Il dénonce la violence du monde moderne et de
ses conséquences désastreuses, non seulement sur les plus défavorisés
des pays riches mais surtout sur les populations des pays pauvres
rendues souvent encore plus pauvres par les techniques importées qui
déstructurent ces communautés.
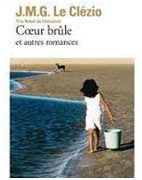


Cette violence du monde urbain, on la retrouve dans ses œuvres des années 60-70, en particulier dans Le déluge (1963), Le livre des fuites (1969), La guerre (1970) ou Les géants (Hyperpolis, 1971).
Dans ses œuvres
postérieures, il met plutôt l'accent sur les problèmes de ces
populations, sur le poids de leurs difficultés, souvent au bord d'un
misère physique et morale. Citons en particulier des œuvres comme ses recueils de nouvelles La ronde et autres faits divers (1982), Cœur brûle et autres romances (2002) ou Histoire du pied et autres fantaisies (2011) et ses récits, Poisson d'or (1997), Révolutions (2004) ou Tempête (2014).
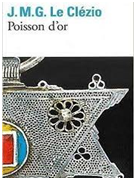
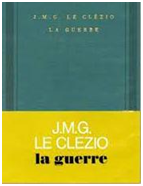
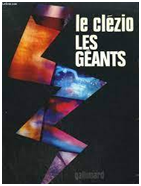
Notes et références
[1] Constitués de deux textes : Pour le premier (Hasard et Angoli Mala), pour le deuxième (La Tempête et Une femme sans identité) et pour le troisième (Chanson bretonne et L'enfant et la guerre) ou même Désert, les histoires de Nour et de Lalla.
[2] On
pourrait aussi citer : Printemps et autres saisons (1989), Coeur brûle
et autres romances (2000) ou Histoire de pied et autres fantaisies
(2011)
[3] "La rivière Taniers" pages 143-154
[4] Voir son récit autobiographique dans sa nouvelle L’enfant et la guerre de son livre Chanson bretonne.
[5] "Avers", pages 9 à 60
[6] "Le chemin lumineux", pages 61-78
[7] "Fantômes dans la rue", pages 99-134
[8] "La Pichancha", pages 79-98
[9] "Hanné" pages 155-178 et Etrebema pges 179-220
Voir aussi